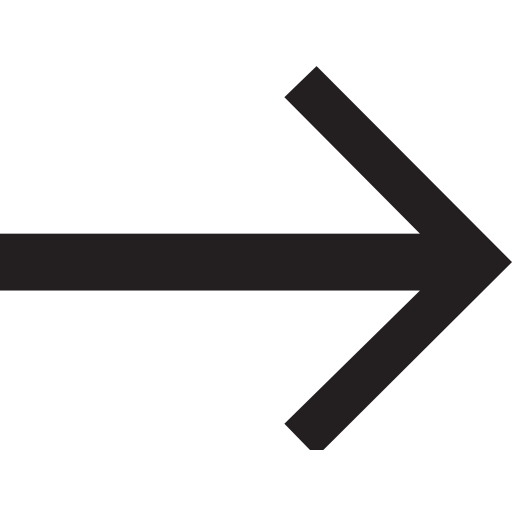Post 2 : Petrouchka d’Igor Stravinsky
Cher.es lecteurs, lectrices, belges, belges, monsieur le président, monsieur le premier ministre, monsieur Hamdi, monsieur Collardey, public chéri : mon amour.
Et oui, je pourrais vous dire qu’après un premier post, j’avais besoin de vacances, d’une pause de 5 mois bientôt, pour trouver l’inspiration, pour envoyer un second classique à propos de cette crise existentielle qu’on traverse tous, mais il n’en est rien. (si vous n’avez pas compris je vous renvoie à la lecture de mon premier post sur ce blog, ou blogue). Public, si je n’ai rien écrit, c’est parce que tu ne m’as pas manqué, je m’explique. Ecrire le premier moment de vie a été un véritable exutoire, et m’a inspiré beaucoup d’autres posts qui ont mûri dans ma tête, mais rien n’a transcendé la paresse qui m’empêche de les écrire. Il a fallu que je déclare à monsieur Hamdi (preuve à l’appui) que « Je suis un moins que rien si ce soir avant minuit vous n’avez de mes nouvelles sur ce blog ! »
Ainsi, avant de vous embarquer dans la suite de mes pérégrinations au travers de mes souvenirs je souhaite vous divertir, avec l’aide d’un pantin boiteux et moche : le fameux Petrouchka d’Igor Stravinsky. Certains termes sont destinés à des personnes maîtrisant le vocabulaire de la musique de tradition européenne de conservatoire, néanmoins j’ai essayé de vulgariser la plupart des éléments pour les rendre compréhensible pour des lecteur.ices non-initiée.es !
Dans le cadre de mon cours d’analyse 2ème année au conservatoire régional de Paris (CRR), classe d’Aurélie Bouchard, j’ai réalisé un exposé sur cette œuvre. Ainsi, pouvons nous en tirer un support sur lequel s’appuyer durant la lecture de ce post : je vais en effet apporter des compléments d’informations et des explications pour essayer de répondre à une question posée.
Voici un lien trop long pour accéder au support. Je précise qu’il contient beaucoup d’extraits audios et vidéos qui sont à écouter, pour comprendre quel instant précis illustre le propos, ou encore se mettre dans l’ambiance, ou sont tout siplement des ressources importantes pour la compréhension. Vous pouvez écouter le début de la pièce sur l’inser de la première slide du support, je précise que les extraits utilisés viennent de la version Orchestre Symphonique de Cleveland / Pierre Boulez chez Deutsche Grammophon, qui est pour le moment la version qui me plaît le plus, Boulez étant notemment connu pour être un grand intérprête et analyste de l’oeuvre de Stravinsky. Cet exposé ayant pour but d’être intercatif, n’hésitez pas à poser des questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre dans les commentaires prévus à cet effet en bas de page !
Ainsi nous parlons de Petrouchka de Stravinsky. Nous sommes dans le Paris des années 1910. Voici plusieurs années que chaque saison, un homme fait le buzz à Paris, un russe. Serge Diaghilev. Il a commencé avec des expositions d’art russe, puis a fait représenter des opéras russes. Puis c’est avec sa troupe des ballets russes qu’il crée l’évènement (un ballet est un spectacle chorégraphique, il s’agit donc ici d’une troupe de danseurs.euses). En 1909 la troupe avait montré le meilleur de la danse académique telle qu’on la pratiquait depuis l’arrivée à Saint-Pétersbourg de Marius Petipa (célèbre chorégraphe). En 1910 Diaghilev à l’idée de représenter en une seule œuvre la danse et la musique moderne russe, il donne l’Oiseau de feu, dont la musique est composée par Igor Stravinsky. En 1913, leur troisième collaboration fait un scandale retentissant : le sacre du printemps. Il serait intéressant de faire un post pour prendre le temps d’en parler de ces deux spextacles, mais nous parlons aujourd’hui de Petrouchka, plus méconnue que les deux autres pièces, et crée le 13 juin 1911.
La partition nécéssite un orchestre symphonique gigantesque pour être interprétée, plusieurs danseur.euses : elle raconte l’histoire d’une scène populaire russe en quatre tableaux : Un jour en plein milieu de la foire de Mardi gras, place de l’amirauté à Saint-Pétersbourg, un charlatan apparaît et rassemble la foule devant son stand, où par l’utilisation d’un sortilège, des pantins prennent vie, et développent des sentiments. Parmi eux, Petrouchka - le héros boiteux, tordu et malheureux-, une ballerine, et un opulent et violent maure. Ils prennent vie dans une danse, puis nous passons au second tableau qui est un thêatre dans le théâtre. Nous sommes dans la chambre de Petrouchka, qui est triste puisqu’il aime la ballerine mais que cet amour n’est pas réciproque. La ballerine le rejoint momentanément, mais Petrouchka est tellement maladroit qu’il la fait fuir et replonge dans sa tristesse. Le troisième tableau prend place chez le maure, où la ballerine arrive dansant avec une trompette. Elle est éprise du maure et ils danseront une valse viennoise ensemble, jusqu’à l’irruption de Petrouchka, qui va se battre en duel et se faire tuer par le maure. Le public du charlatan est sous le choc, nous revenons dans la foire pour le quatrième tableau. Le vieux sorcier rappelle que tout ça n’est qu’un trucage et que c’était évidemment pour de faux. Après le passage d’autres forains et leur stand (notamment un moontreur d’ours) des cris atroces font fuir les passants : il s’agit du spectre de Petrouchka qui terrorise la foule, et vient effrayer le vieux fou qui lui a fait prendre (et perdre) vie.
Voilà pour l’histoire, interessons-nous désormais aux critiques des journaux au lendemain de la première de ce spectacle, au théâtre du Chatelet. (Vous pouvez passer à la deuxième slide sur la présentation)
Au lendemain de la soirée du Chatelêt, les journaux ne lésinent pas sur les commentaires, la plupart élogieux comme dans Comedia : « Rien ne peut donner une idée de l’impression produite hier soir sur le grand public par la première audition de Petrouchka, fantaisie burlesque due à la collaboration de messieurs Stravinsky, Fokine et Benois. Cette scène trucculente de la vie populaire russe, que l’on croirait sortie du pinceau de Degas ou de Manet surprend d’abord le spectateur et le subjugue par son charme étrange et pénétrant. »
Le Figaro du 17 juin 1911 essaie de rendre compte du spectacle des ballets russes : « Petits atomes habilement colorés, habilement réunis, habilement présentés, et d’une manière si heureuse qu’ils ils illusionent et peuvent séduire. Un orchestre extraordinairement chatoyant, varié, inventé, un sens du mouvement musical et du mouvement scénique, très grand l’un et l’autre, achèvent ce miracle d’équilibre. Petrouchka n’exigeait sans doute pas plus que ce pittoresque tout extérieur, mais le talent de monsieur Stravinsky dépasse l’agrément de ses curiosités. »
Le Gil Blas ne s’en laisse pas compter et ne voudrait pas avoir l’air d’admirer sans critiquer : « La musique qui est l’oeuvre de monsieur Stravinsky, que l’on aima davantage dans d’autres ballets, tel cet étonnant Oiseau de feu, est d’une invention surprenante, sinon d’une bien précieuse qualité. Je ne puis juger dans quelle mesure elle emprunte aux mélodies populaires russes. Mais elle sonne « peuple » le mieux du monde. Et sans doute, parce que la foule n’est que la foule, elle n’est pas dépourvue de vulgarité. Mais l’orchestration abonde en imprévus : les timbres s’y opposent, ou s’y confondent, pour notre plus grande surprise! Certains instruments, le basson et la trompette surtout, semble s’y divertir prodigieusement, et par cela-même, ils ne cessent point d’amuser, c’est du très joli ouvrage d’agrément. »
Enfin, concluons cette courte revue de presse avec l’opinion du critique du journal l’Attaque : « Les tons volontairement crus de l’instrumentation, le dégingandement des rythmes et de la composition, tout cela est agencé avec beaucoup d’habileté, haut en verves et en couleurs. Et si il ne s’agit que d’une charge un peu trop prolongée, du moins le comique en est-il gai et le mouvement endiablé mais cela est aux limites de la musique, monsieur Monteux dirige l’orchestre non sans adresse »
Une remarque récurrente nous saute aux yeux : la critique n’en revient pas de la modernité du spectacle proposé. Nous allons donc essayer, à travers quelques axes d’analyse, de proposer des pistes de réflexions pour justifier les surprises et audaces d’Igor Sravinsky à travers la pièce. (3ème slide) : il sera donc question
- de l’orchestration (le choix d’emploi d’un instrument ou d’un autre pour jouer un motif : pourquoi une trompette ici, pourquoi un trombone pour faire la basse, une clarinette pour le thème principal, pour jouer ce personnage là ? Etc)
- de la forme (structure) et d’expériences à ce sujet
- du matériel de compostition : invention de nouveaux objets harmoniques, accords dissonants (qui sonnent faux), superposition de tonalités, de rythmes, d’accents décalés etc.
I) La modernité de l’orchestration
1) les timbres (variétés de son) utilisés conjointement au service d’une couleur (fusion) : slide 4.
Stravinsky était passionné par les instruments mécaniques, en particulier l’orgue de barbarie. C’est pourquoi, pour symboliser un orgue de barabarie dans la foire, il va agencer les bois de l’orchestre (clarinettes, flûtes, bassons et hautbois) de manière à produire le son d’un orgue de barbarie, du jamais vu à l’orchestre. Extrait à écouter sur le support. Jean-François Zygel a tourné un épisode des « Clés de l’orchestre » où il décortique, explique, raconte Petrouchka, je vous recommande vivement de voir ce documentaire en libre accès sur youtube, (lien en bas de page) pour approfondir. Dedans il fait entendre distinctement les instruments précédemment cités, dans l’assemblage « orgue de barbarie ». L’orgue joue d’ailleurs une rangaine populaire d’Emile Spencer, la jambe en bois (extrait à l’appui) : (et pour l’anecdote, à chaque représentation de Petrouchka, une part des recettes étaient versées aux ayants droits de Spencer qui ont crié au plagiat, alors qu’il s’agit en vérité d’une claire citation). Stravinsky fait d’ailleurs apparâitre cet instrument puisqu’un musicien itinérant jouait la jambe en bois en bas de la fenêtre de son hôtel pendant la période de composition de l’oeuvre.
Le même procédé est utilisé pour faire un simulacre de boîte à musique.
2) les timbres utilisés en temps qu’évènement individuels, (en rupture). Slide 5
Dans le quatrième tableau, au moment du passage du montreur d’ours et de sa bête, Stravinsky figuralise l’ours par un solo de tuba, l’instrument le plus grave de la famille des cuivres. Le paysan qui s’occupe de la bête lui, est incarné par les deux clarinettes à l’unisson dans un effet cinglant. En écoutant l’extrait on pense à une farce, ces instruments dans un mode de jeu aussi rutilant (je rappelle que nous sommes en 1911) ont de quoi daire sursauter la critique, alors que les compositeurs conservateurs du 19ème siècle sont toujours en vie et continuent d’écrire de la musique encore dte romantique, c’est ici quasiment un cri de clarinette que Stravinsky écrit, et c’est très rare qu’un tuba soit utilisé dans un rôle aussi soliste à l’orchestre : il en est de même pour la trompette, jouée par la ballerine à son arrivée chez le Maure, dans une sorte de sonnerie militaire (puisqu’accompagnée par la caisse claire) mais tout à fait mélodique, avec des phrases legato conjointes, ainsi que des aprèges de neuvièmes majeures. Ce solo est d’ailleurs « un tube » du répertoire des trompettistes, il est demandé à chaque concours d’orchestre, puisqu’il demande une grande habileté technique et un sens aiguisé du phrasé pour être interprêté. Ce genre de motif, de fanfare militaire mélodique, où TOUT l’orchestre s’arrête n’existe qu’ici.
II) Expériences sur la forme : slide 6
Il est impératif de regarder la vidéo de Pierre Boulez (chef d’orchestre, compositeur, pédagogue, analyste, fondateur du domaine musical, qui deviendra plus tard l_‘ensemble inter-contemporain_) : qui décrit la forme « mosaïque » du premier mouvement. Comme il est explique, en rupture avec le modèle allemand du développement, où un motif simple peut entretenir un fil conducteur développé pendant un temps variable (+ de 30 minutes pour certaines symphonies de Gustav Mahler) Stravinsky emploie une esthétique de collage, non linéaire, où chaque motif peut réapparaître à l’identique, donnant un aspect immersif en plan séquence, une dimmension cinématrographique, dans une musique déjà prévue pour la scène et la danse.
On peut voir sur le support les motifs employés pour le tout début de la pièce ainsi qu’un déroulé de leur utilisation, je vous invite à lancer l’extrait et à essayer d’identifier les motifs tout en suivant le déroulé pour les voir apparaître.
On se rend facilement compte, qu’avec 5 éléments très légèrements variés, non développés, Stravinsky écrit 5 minutes de musique non rébarbative qui ne tourne pas en rond. Là aussi, cela illustre au-delà d’une grande modernité, une grande habileté de technique compositionnelle.
III) Inventivité des moyens de compostition, slide 7
Ici, pas vraiment besoin d’ajouter de complément au support, vous pouvez écouter les extraits correspondants aux procédés cités : décalages des accents et articulations sur une phrase qui semble à première vue linéaire, l’utilisation d’un « objet » harmonique nouveau, l’accord Petrouchka, qui est la superposition de l’accord parfait de Do majeur et celui de Fa# Majeur, ainsi les notes sont séparés par la distance d’un intervalle appelé Quartre augmentée, ou triton : volontairement très dissonant. Cet objet harmonique non-identifié sert de leitmotiv (motif récurrent, mot qui provient des opéras de Wagner, où un thème / un instrument représente un personnage) au pantin Petrouchka. On en déduit la gamme diminuée (ou mode 2 de Messiaen) construite en [demi-ton, ton], [demi-ton, ton] … etc, ou bien [ton, demi-ton] , [ton, demi-ton] , etc. Tout cela nous rappelle les recherches de Monsieur Wollny mais il y a plus de 100 ans…
Le même procédé est utilisé de façon synthétique avec deux clarinnettes : une arpégeant do majeur, l’autre arpégeant fa# majeur. Extraits à écouter.
Slide 8, on parle souvent du sacre du printemps comme révolution en terme d’aggressivité rythmique, mais on oublie que nombreuses sont les idées du sacre qui ont germé dans l’esprit de Stranvinsky à travers Petrouchka. En effet les rythmes superposés et l’aggressivité se trouvent déjà dans le quatrième tableau, et un passage polytonal/modal se fait entendre dans la scène chez le Maure. La valse est en Si majeur, pendant que le cor anglais joue une mélopée dans une couleur modale de Sol# mineur, (mélodique descendant pour les plus averti.es d’entre vous, il n’y pas de sensible puisque que le Fa est dièse et non pas double dièse…) Extraits à écouter.
Ainsi, nous voyons à travers tous ces exemples analytiques mais aussi avec les thèmes abordés (la foire, l’anti-héros boiteux, qui sont des thèmes chers au groupe des 6, et dans une mouvance parisienne du début 20ème, proche de Cocteau) l’emploi d’un nombre incalculable de citations au floklore russe, mais aussi à la tradition populaire parisienne (avec la jambe en bois par exemple!) font de ce ballet un spectacle on ne peut plus moderne pour l’auditoire de 1911. Stranvinsky et Diaghilev étaient sans aucun doute des génies visionnaires, avec un sens du spectacle et de la surprise. Vous pouvez voir sur le support en slide de conclusion les décors, de la foire, de la chambre de petrouchka, et des esquisses de costumes.
Pour finir, j’aimerais citer André Warnod sur la modernité du spectacle (et non pas de la musique) « Il faut se souvenir de ce qu’on avait coutume de voir, au théâtre reignait la poussière et la pénombre, les ambiances équivoques, les crépuscules inquiets, leurs troubles où les lampes s’allument. Le décor de Pelléas [et Mélisande, opéra de Claude Debussy, note de Noé] était ce qu’on avait vu de plus beau : la fadeur, la mélancolie, les alanguissements, les couleurs mourantes satisfaisaient les plus difficiles : il est facile d’imaginer alors le fracas que firent dans cette molle douceur, dans ce trucage en carton pâte, les décors russes, un coup de révolver dans la glace ».
J’aimerais remercier Anne-Charlotte Rémond, Lionel Esparza, Jean-François Zygel, et Benoït Faucher, à qui j’ai emprunté beaucoup d’éléments de leur travaux, (slide finale) pour réaliser ce post et cet exposé. Les liens de leurs émissions sont en bas de page.
J’espère que ce post vous donnera envie d’écouter l’oeuvre dans son entiereté, ou de voir le spectacle chorégraphique. J’ai eu la chance de voir la suite pour orchestre 3 fois à la philharmonie de Paris, (il en sera question dans un prochain post). Ou simplement que ça aura piqué votre curiosité, vers le monde de la musique symphonique.
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/igor-stravinsky-chroniques-de-sa-vie
A dans 6 mois public, mon amour.
_
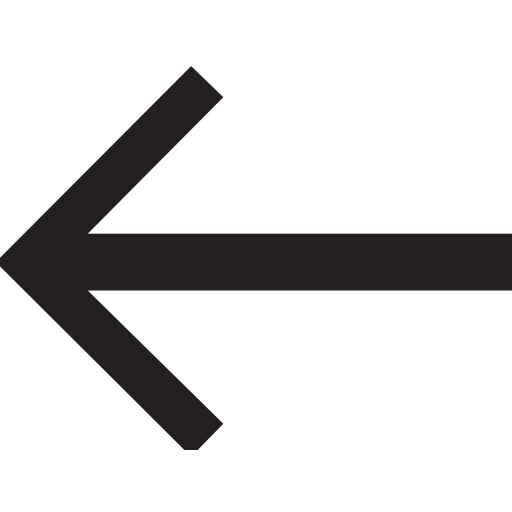 Previous
Previous
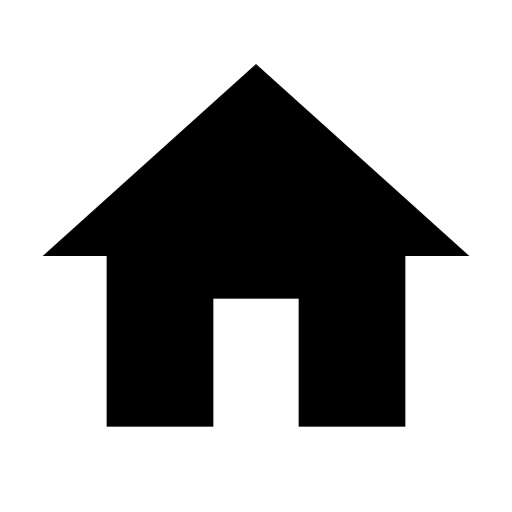 Home
Home